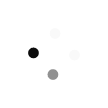Mû par un goût des autres insatiable et éclectique, Julien Chatelin parcourt le monde pour mettre en lumière non pas l’exotisme, mais toute la poésie et la beauté de son ordinaire. Portrait, paysage, reportage, le photographe passe d’un genre à l’autre au gré de sa curiosité, utilisant surtout l’argentique, sans négliger les atouts du numérique. Organisée au Salon H, dans le 6e arrondissement parisien, par l’association One Shot Art Paris, l’exposition Zion Anatomy est extraite de l’un de ses principaux projets menés dans les années 2000 : Israël Borderline, à travers lequel il appréhende, avec subtilité, toute la pluralité et la complexité de la société israélienne. Rencontre.
« J’ai besoin de ruptures, de changements de rythmes et d’univers », confie Julien Chatelin pour expliquer la diversité, tant thématique qu’esthétique et technique, qui caractérise son travail. « Et puis, il est intéressant de casser de temps en temps ses habitudes : cela force à poser le regard d’une autre façon », poursuit ce quadragénaire, passionné par la photographie depuis son adolescence. Après s’y être exercé quelques années en parfait autodidacte – « J‘avais un petit laboratoire où je faisais mes propres tirages et j’adorais çà. » –, il part suivre un cycle d’études de Photographie, parallèlement à un autre de Sciences politiques, à l’université de New York. « A l’époque (NDLR : seconde moitié des années 1980), il y avait une grande différence entre les écoles de photo françaises, où la sélection se faisait par la science – or, j’étais très mauvais – et américaines, qui proposaient aussi un cursus technique, mais associé à des cours d’histoire de la discipline. » Le jeune homme étudie sous la conduite de personnalités – parmi elles, Joel Meyerowitz –, « qui font partie de l’histoire de la photographie. Ce ne sont pas des gens qui vous disent quoi faire, ils savent regarder la photo et en en parlant, tout simplement, vous donner les clés pour progresser, ce qui est, évidemment, très stimulant. Par ailleurs, passer par une école, c’était égalementune manière de me confronter au regard des autres. »
Ses diplômes en poche, il vit quelque temps aux Etats-Unis, dont est originaire sa mère, mais ne résiste pas longtemps à l’attrait exercé par une Europe en plein bouleversement : le Mur de Berlin est tombé, l’ex-Bloc de l’Est est en effervescence. « Je me sentais très éloigné de ce qui agitait le monde à ce moment-là. Je suis donc rentré en France dans l’idée de trouver une agence qui m’envoie dans ces régions en mutation. » S’ensuivent, au début des années 1990, de nombreux reportages en ex-URSS : dans le Caucase et en Asie centrale. Il en gardera une affection particulière pour la Géorgie, où il entretient depuis 20 ans des liens d’amitié. Entre deux voyages, il couvre l’actualité sociale française. « J’ai toujours eu ces deux préoccupations : actu et photo. Je suis devenu journaliste par l’intermédiaire de la photographie, car ce que j’aime avant tout, c’est photographier des gens ; je ne suis pas très doué pour fabriquer des images mais plutôt pour en capturer, c’est pourquoi je me suis orienté vers le reportage. Ma curiosité de journaliste est venue par la suite. »

Pendant deux années, il va s’attacher à décrypter « ce chaos israélien ». « A chaque fois que je traitais un aspect, je m’apercevais que le contraire existait, se souvient-il. Il y a tellement de groupes identitaires, d’univers différents, qui se côtoient, sont mitoyens, se mélangent, parfois, grâce à une spiritualité commune, tout en revendiquant l’existence de frontières politiques, ethniques voire économiques. » Lui, reste frappé par la vitesse à laquelle on peut passer d’un monde à l’autre, par la façon, « propre au pays », dont tout se télescope : « Je pouvais, dans la même journée commencer à travailler dans les colonies, déjeuner à Tel Aviv, faire un portrait et, enfin, suivre une Gay Pride à Jérusalem. Il règne là-bas un espace–temps tout à fait spécifique. »
Aujourd’hui, Julien Chatelin s’est engagé dans une entreprise « radicalement différente », davantage axée sur la géographie et le paysage : « Il y a très peu de personnes sur les images. Je travaille à la chambre. » Débuté en Egypte en 2011, une nouvelle fois en marge de l’actualité brûlante de l’époque, ce projet a pour thèmes centraux la tension existant entre le désert et l’urbanisme et la forme de démesure dont l’homme est coutumier.

S’il semble porté par une indéniable curiosité de l’autre et un goût prononcé pour la découverte, Julien Chatelin se méfie pourtant par-dessus tout de l’exotisme. « Si je me laisse séduire par lui, je serai forcément à côté de la plaque, car maintenu à la surface des choses, hors de la réalité des gens. J’aime débuter un travail lorsque, tout d’un coup, je cesse d’être surpris : il m’apparaît “normal” qu’il y ait des soldats partout dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv, je ne suis plus choqué par le fait d’être fouillé à répétition, je m’habitue aux tensions locales, etc. » Pour autant, le photographe n’en revendique pas moins l’importance de son regard extérieur, qui assure un recul nécessaire : « Il faut à la fois conserver un sens aigu de l’observation, sans se laisser influencer par les différences qui existent entre notre univers et celui qui nous accueille. C’est cette distance-là qui est fondamentale. » Et lui permet, en fin de compte, de parfois « éclairer » les habitants des lieux investis. Montrer ses images aux gens en question fait partie des « tests » auxquels il se prête volontiers. « Parmi les journalistes et photographes israéliens que j’ai côtoyés, par exemple, certains ont apprécié, octroyant une vraie pertinence au propos, d’autres pas, parce que, finalement, je ne montrais rien d’exceptionnel : pour eux, c’était une situation quotidienne, normale et qui, du coup, ne valait pas la peine d’être photographiée. C’était pour moi un compliment. »
* Quartiers résidentiels à l’accès contrôlé.