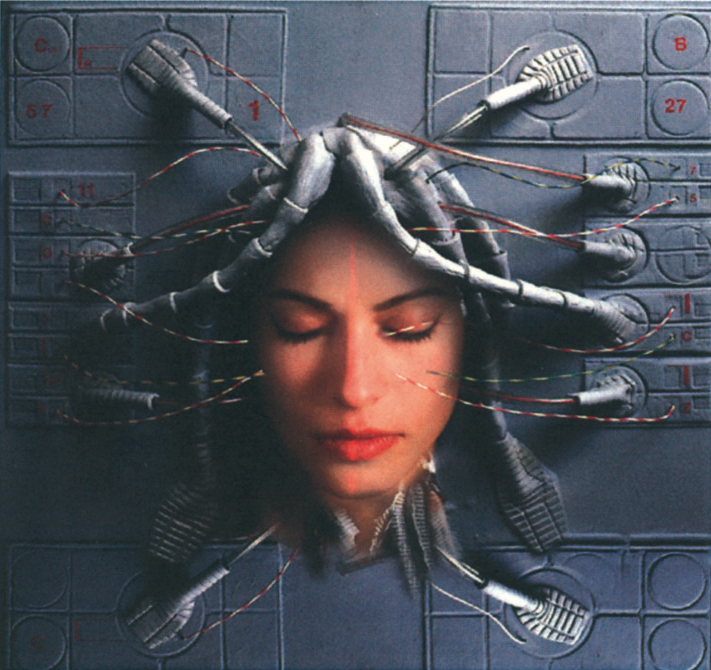Septième épisode d’une série d’articles destinés à l’art numérique que vous pouvez retrouver chaque mardi. Notre objectif est de présenter cet art « nouveau », de le situer dans une continuité historique, d’en analyser le contexte technologique et juridique, d’en découvrir les multiples facettes et d’imaginer ses développements futurs.
L’œuvre numérique : une œuvre comme les autres ?
Aborder le domaine du droit lorsqu’on parle d’art, et notamment de l’économie liée à ce secteur, est une nécessité. Dès lors qu’une œuvre est achetée, exportée, transmise, donnée, reproduite ou téléchargée et que l’artiste décide de vendre, de se lier à une galerie, de prêter, de céder une partie de ses prérogatives ou de faire une donation, le droit est présent. L’œuvre d’art se distingue d’un objet ordinaire par la relation singulière que son créateur entretient avec elle. Déjà en 1767, Diderot mettait en évidence le lien inaltérable qui lie l’auteur à son œuvre. Il s’agissait alors de protéger des œuvres littéraires et d’empêcher qu’elles soient dupliquées sans que l’auteur ne reçoive une rétribution. Au fil du temps le législateur a confirmé ce lien particulier d’où est issu le droit d’auteur. S’il est issu du monde des lettres, le droit d’auteur s’est rapidement appliqué au domaine des arts pour se révéler incontournable au fur et à mesure que l’œuvre se détachait de son support et qu’on pouvait la reproduire. Aujourd’hui, l’avènement du numérique est peut-être à mettre en parallèle avec l’invention de l’imprimerie. On sort définitivement de l’objet unique pour dupliquer à l’infini. L’œuvre numérique n’est pas un objet, il lui faut donc plus que toute autre être protégée par un outil juridique. Si l’œuvre d’art peut relever de l’espace législatif dans bien des domaines (commerce, successions, assurances…), c’est le droit d’auteur qui détermine ses spécificités et lui accorde son seul moyen de protection (L111.1 CPI). Une œuvre d’art est une œuvre de l’esprit mais toutes les œuvres de l’esprit ne sont pas des œuvres d’art. Si le législateur prend soin de ne pas définir ce qu’est une œuvre, il déclare pourtant que l’objet de la protection par le droit d’auteur ne concerne que les créations de forme originales. Entendons par là que les idées sont de libre parcours, qu’elles doivent donc être mises en forme et porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur pour être protégées. Cette empreinte est garante de l’unicité et de l’authenticité de l’œuvre. Deux caractéristiques dont découle historiquement sa valeur économique. Les œuvres numériques ne dérogent pas à ces principes mais leur nature « immatérielle » pose un certain nombre de questions au point que d’aucuns évoquent la possibilité d’un statut particulier.
Quand en 1917 Marcel Duchamp décide d’exposer Fontaine, un urinoir renversé sur lequel il a apposé sa signature, non seulement il provoque un tollé parmi les organisateurs de l’Armory Show à New York qui refusent de présenter la pièce, mais ébranle les certitudes d’un milieu de l’art que les ready-made contraignent depuis quelques années à une réflexion sur la nature de l’œuvre. Si, pour l’artiste, il s’agit de détourner la signification d’usage d’un objet de la vie courante et de lui offrir le statut d’œuvre d’art du seul fait qu’il est exposé dans un musée, force est de constater que si œuvre il y a, elle est conceptuelle, c’est-à-dire dans l’idée. Le chemin ouvert par Marcel Duchamp est large et de nombreux artistes et courants s’y sont engouffrés tout au long du XXe siècle, créant sans nul doute une certaine confusion entre la notion de forme et celle d’idée. Un trouble que l’arrivée du numérique n’a fait qu’exacerber. Cette nouvelle technologie capable de transformer (pour les diffuser plus facilement et plus largement) textes, images (fixes ou en continu) et sons en une suite de chiffres (0 et 1) a permis de qualifier les œuvres émanant d’elle d’« immatérielles ». L’œuvre ne prenant « corps » qu’à travers un support, mais n’étant pas tangible, certains se sont interrogé sur la réalité de cette nouvelle venue que seul un code est à même de révéler. Pourtant nul n’oserait remettre en cause la qualification d’œuvre pour une symphonie ou un concerto alors que son existence physique n’est prouvée que par des partitions, soit un code parmi d’autres. Malgré ce caractère intangible, les œuvres de réalité virtuelle de Miguel Chevalier ou celles de Maurice Benayoun sont indéniablement, à l’instar de sculptures ou de peintures, des créations parfaitement originales portant l’empreinte de leur auteur. Peu importe donc que l’on puisse ou non les toucher du doigt. Notons par ailleurs que les pratiques très conceptuelles de certains artistes du Web, comme Fred Forest, ont posé de nouveau la question de la nature de l’art sans pour autant émouvoir le législateur qui applique aux œuvres sans corps physique les mêmes règles qu’aux autres. Précisons toutefois qu’elles ne sont pas toutes identiques (hybride, image fixe, vidéo, interactive, participative, générative, site Internet) et qu’elles ne sont pas forcément créées par une seule et unique personne. En effet, dans le monde numérique les œuvres requièrent des compétences très diverses et sont donc très souvent des œuvres collectives. Comme pour une œuvre collective « classique », c’est l’instigateur de l’œuvre qui est investi des droits de l’auteur. Quand bien même il fait appel à des développeurs, graphistes, musiciens ou autres, l’artiste n’en reste pas moins l’initiateur, et son œuvre, originale. Comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 1993 : une œuvre est originale si elle « émane de la main de l’artiste ou a été réalisée selon ses instructions et sous son contrôle ». L’artiste titulaire des droits d’auteur est donc le seul à pouvoir l’exploiter et en tirer profit. Là encore rien de spécifique à l’œuvre numérique.

Les usages poussent le droit d’auteur
Le droit d’auteur fait partie de la culture numérique. En l’étudiant à l’aune de la révolution technologique des dix dernières années, il est possible non seulement de mettre en évidence ses limites mais aussi les potentialités nées du numérique. « Droit et économie numériques sont intimement liés. Le droit est subordonné au numérique. Il est un outil de régulation, qui gère les conflits d’intérêts, les rapports de force entre les producteurs, les diffuseurs, les ayants droit… Mais il n’est pas un outil de développement, de stabilisation ou d’encadrement des usages. Le droit suivra l’économie, j’en suis convaincu », explique Jean-Marc Wallet, directeur de la Filiale ULR Valor à l’université de La Rochelle et spécialiste en droit du multimédia. En effet, l’arrivée du numérique, comme toute autre invention technologique, et par ailleurs assortie de l’expansion d’Internet, n’a pas pu être anticipée par le droit. Qui aurait pu, par exemple, imaginer la capacité du Net à devenir le premier diffuseur mondial d’informations ou anticiper le partage des contenus ? De la même manière que la technologie pousse les usages, les usages, eux, poussent le droit. Au début, ils s’expérimentent en dehors des lois, ils meurent ou au contraire se développent et c’est seulement lorsqu’ils deviennent majoritaires que sonne l’heure du droit. La régulation est d’abord économique avant d’être juridique : il faut trouver de nouveaux modèles, permettre la monétisation des nouveaux services et donc la création des conditions de pérennité de l’activité. L’arrivée du numérique a bouleversé des pans entiers de l’économie notamment dans les domaines de la culture et des loisirs. Les filières de l’audiovisuel, du livre, de l’information, de l’art… sont en pleine mutation et tentent de relever le défi de la monétisation du contenu ou celle de l’audience.

Le droit pour le moment observe et les juges parent au plus pressé en interprétant les règles existantes confrontées aux nouveaux usages. Un fossé existe entre la loi et la réalité des pratiques. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la diffusion des œuvres sur le Net : la plupart le sont dans l’illégalité. Normalement, pour chacune d’entre elles, la personne à l’origine de sa diffusion aurait dû s’adresser à l’artiste ou à la société qui gère ses droits pour obtenir une autorisation et, le cas échéant, payer un droit de diffusion. Il n’en est rien et l’idée de mettre un gendarme derrière chaque internaute a fait long feu. Les sociétés de gestion des droits, comme l’Adagp (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques), cherchent les moyens de pallier les usages qui se multiplient sans pour autant rapporter quoi que ce soit dans leur escarcelle. En 2008, seulement 1,60 % des revenus de l’Adagp (soit 360 000 euros des 22,5 millions perçus) provenaient des acteurs d’Internet alors que le Web est aujourd’hui le plus important mode de diffusion. Dans l’incapacité de tracer toutes les œuvres (le marquage reste cher et la surveillance exhaustive du Net impossible) et de faire payer les contrevenants (même s’ils sont localisés, il est actuellement plus simple et moins coûteux de leurs demander de retirer l’œuvre du Web que de les obliger à payer), les sociétés de droits d’auteur tentent actuellement d’établir des contrats généraux avec les acteurs dominants comme Google, E-bay, YouTube ou Flikr. Pour le moment, « seul Dailymotion a accepté de reverser un petit pourcentage de ses recettes pour permettre la rémunération des auteurs dont les œuvres sont diffusées sur son site », confirmait fin 2009 Christiane Ramonbordes, directeur général de l’Adagp. La plupart des sites utilisent pour se défendre la directive européenne de 2001 qui exonèrent de toute responsabilité ceux qui sont considérés comme des hébergeurs (Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, alinéa 27). Deux remarques s’imposent. D’une part, les hébergeurs affirment pour leur défense qu’ils ignorent ce qui est publié sur leur site, pourtant nombre d’entre eux sont capables de filtrer le contenu (pas de photos ou de propos racistes, pornographiques, etc.) et de placer des propositions commerciales relatives, ou ayant un rapport direct, avec ce qui s’affiche à l’écran. Les hébergeurs ne sont donc pas si aveugles.
D’autre part, il faut signaler que les contrats généraux s’attachent à la rémunération liée à la diffusion en faisant passer au second plan le droit exclusif de l’auteur c’est-à-dire le pouvoir d’autoriser au préalable ou de refuser la diffusion de son œuvre et d’obtenir une rémunération proportionnelle aux utilisations. Pour le moment les sociétés d’auteurs refusent les solutions globales tel que le prélèvement d’une taxe sur les abonnements Internet ou sur chaque terminal car elles ne sont pas prêtes à accepter la disparition du droit exclusif et de la demande d’autorisation, ce qui, selon Christiane Ramonbordes, équivaudrait à ouvrir une sorte de « grande boîte de Pandore où personne ne contrôlerait plus rien ». Et d’ajouter : « Mais j’ai bien peur qu’on y arrive parce que, quelque part, il n’y a pas d’autres moyens. » Ce constat d’impuissance face à la montée des usages impossibles à contrôler, du moins pour le moment, se double d’un autre danger : la difficulté à contrer des initiatives de mise à disposition en masse de contenus telle que la bibliothèque numérique de Google. Le 13 novembre 2009, une nouvelle version de l’accord entre le géant de l’Internet et les auteurs et éditeurs américains a été dévoilée. Il ne s’applique plus qu’aux œuvres enregistrées au bureau américain du copyright et aux pays anglo-saxons qui partagent « un même héritage juridique » avec les Etats-Unis et des pratiques similaires dans le monde de l’édition (Royaume-Uni, Australie, Canada). Si les éditeurs français ou allemands ne sont donc pas concernés, Google n’a pas renoncé à son souhait de numériser l’ensemble des livres de la planète et a l’intention de contacter directement les ayants droit à l’étranger pour essayer de « rendre les contenus accessibles dans le monde entier » (source : Le Monde du 15 novembre 2009). Google a déjà numérisé quelque 6 millions de livres épuisés mais n’a pour le moment pu qu’en montrer des extraits. La compagnie espère vendre des abonnements à sa bibliothèque digitale, ainsi que des copies individuelles des livres. Le verdict du juge fédéral Denny Chin concernant cet accord, qui devait intervenir le 18 février, a été remis à plus tard, alors qu’une nouvelle plainte a été déposée, cette fois émanant de l’American Society of Media Photographers et d’autres associations représentant des illustrateurs et artistes visuels.

Même si un projet de bibliothèque numérique européenne existe (Europeana, quelques dizaines de milliers de documents numérisés à ce jour et qui envisage d’emblée des liens avec Google et d’autres services en ligne réputés comme Wikipedia), on observe une capacité de mise en œuvre et une volonté d’avancée hors du commun de la part de Google. Il est évident que pendant qu’en France et en Europe on se pose des questions sur le monopole (voir l’intervention du professeur Annette Kur lors d’une audition de la Commission de la culture, de la science et de l’éducation du Conseil de l’Europe en date du 9 décembre 2008), le droit d’auteur et l’accès universel à la connaissance, l’Américain aura mis à la disposition du public un véritable trésor… en langue anglaise ! Quid alors de la littérature française ou allemande et donc du rayonnement de nos cultures et spécificités ? Qu’arriverait-il demain si Google décidait de créer le plus grand musée numérique du monde ? Les artistes contemporains français y seraient-ils représentés ? Comme le souligne Christophe Geiger dans un rapport rédigé pour la Commission de la Culture, de la Science et de l’Education de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, visant à éclairer les travaux du Conseil dans le cadre de la préparation d’une recommandation sur l’avenir du droit d’auteur en Europe (juillet 2009, version révisée en octobre 2009) : « On peut estimer que c’est l’aptitude du droit d’auteur à intégrer des logiques antagonistes mais complémentaires qui attestera de sa pérennité dans le futur et de sa capacité à s’adapter à un nouvel environnement économique, technologique et social. » Pour résumer, le droit d’auteur doit continuer à être une protection et une source de revenus pour les créateurs mais en évitant de devenir un frein à la diffusion de leurs œuvres auprès du grand public, au risque de demeurer dans l’ombre.
Attaqué pour sa bibliothèque, Google a ouvert immédiatement un autre « front ». Le géant de l’Internet a confirmé le lancement en juin prochain de sa librairie en ligne dans six pays, dont la France. Les internautes pourront ainsi acheter des ouvrages numérisés à lire sur des terminaux comme l’e-book Kindle d’Amazone, l’iPad d’Apple ou encore la future tablette numérique de… Google ! 30 000 éditeurs proposeront leurs ouvrages contre 65 % du chiffre d’affaires généré par le service (source : abondance.com). Parallèlement, 400 librairies française ont annoncé qu’elles s’apprêtaient, elles aussi, à vendre des livres numérisés.
Des nouvelles possibilités nées du numérique
L’utilisation conjointe du numérique et d’Internet a permis à certains artistes de se passer d’intermédiaires pour rencontrer leur public. Nombre d’entre eux ont décidé d’abandonner tout réflexe protectionniste et de jouer la carte de la diffusion maximale en créant des sites personnels, en déposant des œuvres sur des sites de partage, en créant leur profil sur Facebook, en échangeant des informations sur des sites participatifs… Certains sont même allés plus loin en cédant d’emblée tout ou partie de leurs droits. Inspirés par les licences libres et l’open source, sont nés les contrats « creativ commons » qui se présentent ainsi : « Simples à utiliser et intégrées dans les standards du Web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site Web… » (source : http://fr.creativecommons.org) Les auteurs peuvent aussi préciser pour chaque œuvre « Some rights reserved », soit : « Seuls certains droits sont réservés » ce qui est une alternative au fameux « DR » habituel où tous les droits sont réservés. Il existe également le copyleft : une initiative née dans le milieu du logiciel libre. L’auteur donne l’autorisation de copier, d’utiliser, d’étudier, de modifier et/ou de distribuer son œuvre dans la mesure où ces possibilités ne disparaissent pas ensuite. Les créations réalisées à partir d’éléments sous copyleft héritent de cette caractéristique. Les artistes numériques peuvent ainsi reprendre la main sur la gestion de leurs droits. Une perspective qui n’enchante pas les sociétés d’auteurs.
Ce fonctionnement à plusieurs vitesses crée une forme de confusion, notamment auprès du public, qui finit par ne plus savoir ce qu’il peut ou ne peut pas faire, et vient encore alimenter la polémique ; en échange, il offre probablement une alternative raisonnable en permettant la diffusion et l’utilisation des œuvres dans une perspective d’information ou de création tout en réservant l’application des droits à la sphère commerciale. A noter que si le numérique a favorisé la diffusion des œuvres, il a aussi facilité la pratique artistique classique de l’emprunt. Une pratique qui est aujourd’hui encore encadrée par les règles strictes du droit d’auteur mais qui pourrait à l’avenir bénéficier d’une exception d’utilisation à des fins créatives comme l’envisage le Livre Vert adopté le 16 juillet 2008 par la Commission européenne.
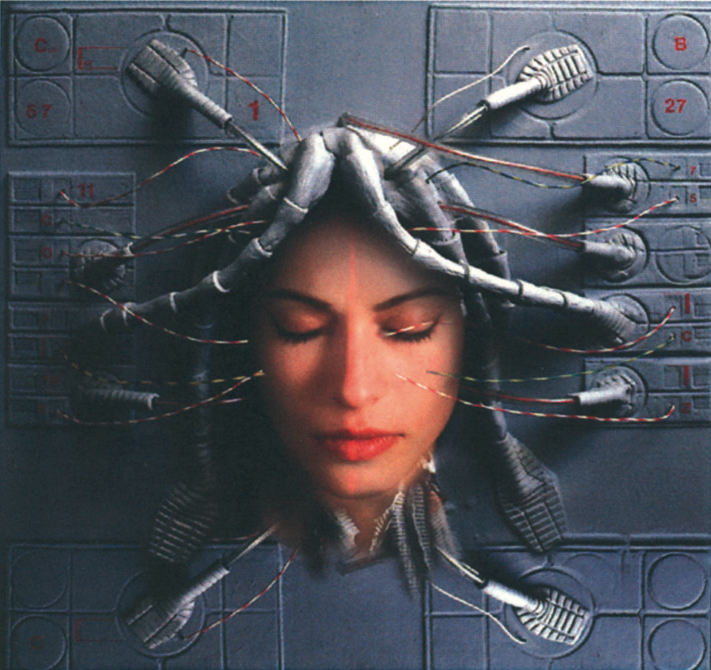
Par ailleurs, le numérique permettrait une gestion plus facile des œuvres grâce aux métadonnées (ensemble des informations techniques et descriptives ajoutées à un document numérique pour mieux le qualifier). Ces informations intrinsèquement liées aux œuvres pourraient faciliter leur utilisation. Depuis son apparition, le droit d’auteur est non formaliste.
Il n’oblige ni à déclarer une œuvre ni à fournir sur elle des précisions. Ce qui s’avère dans le monde du papier un casse-tête de paperasserie administrative devient un jeu d’enfant dans le monde numérique. Fini les œuvres orphelines, les créateurs inconnus, non localisables et peut-être plus important encore, fini de feindre l’ignorance : les métadonnées vous indiquent les autorisations à demander, les utilisations possibles, les droits à acquitter… L’œuvre ne se sépare plus de son histoire, de sa carte d’identité et elle peut être indexée. Bien entendu, la présence de métadonnées n’est pas la réponse à tout. Il faudrait également qu’il existe un dépôt électronique des œuvres qui permettrait, d’une part, d’obtenir un numéro d’authentification et, d’autre part, la conservation d’une description écrite de l’œuvre que l’on pourrait nommer « notation », comme pour les chorégraphies, et qui assurerait sa pérennité au cours de ses migrations successives à travers le temps. Cette notation rendrait compte de l’ensemble des paramètres de l’œuvre et garantirait qu’aucun élément fondamental pour l’artiste n’a été modifié par le passage d’un format à un autre. Elle serait aussi remise à chaque acheteur d’une œuvre numérique. Ce qui est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui pour certaines œuvres complexes qui sont prêtées ou vendues avec un « mode d’emploi ». Le principe mériterait d’être généralisé et formalisé pour faciliter la circulation, la protection, l’utilisation et la vente des œuvres numériques et crédibiliser l’ensemble de la filière.
Faire face aux enjeux du numérique
Si l’œuvre numérique est bien une œuvre comme les autres et bénéficie du même arsenal de protection, il faut admettre que le droit d’auteur est aujourd’hui malmené. L’association du numérique et d’Internet a multiplié à l’infini les possibilités de diffusion et d’utilisation (certains vont même jusqu’à s’interroger sur la notion de « copie privée » et se demandent si elle ne doit pas être remise en cause. Ne vise-t-elle pas, en effet, un usage de l’œuvre dans la sphère privée – mise à mal par des téléchargements dont on ne sait jamais d’où ils sont effectués et par le caractère spécifique de l’œuvre numérique qui, à défaut de copies, possède un nombre incalculable d’originaux).
En outre, le droit à l’information, conséquence de l’explosion d’Internet, est de plus en plus revendiqué. Pour faire face aux enjeux et aux défis lancés par le numérique, les artistes vont avoir besoin d’accompagnement. Qu’ils soient tentés par une position protectionniste et souhaitent faire marquer leurs œuvres ou qu’ils décident de jouer la carte de la diffusion la plus large, ils vont avoir besoin au minimum de conseils au mieux d’aide à la gestion de leurs œuvres. Le droit d’auteur n’impliquant aucun dépôt des œuvres, il est intéressant de se demander : qui possède l’information ? Aujourd’hui, elle est détenue par les artistes, les galeries, les institutions… mais il n’existe aucune source centralisée. Certains professionnels de par leur activité cherchent en permanence cette information et sont capables de l’exploiter. Il s’agit, par exemple, des grandes agences de photos comme Getty images qui, après avoir recherché les ayants droit, proposent des photos pour lesquelles ils sont désormais mandatés. L’information est aux mains de sociétés privées qui peu à peu pourraient proposer aux artistes de gérer de manière plus souple leurs droits à la place des sociétés d’auteurs.

Par ailleurs, le souhait exprimé de plus en plus couramment de marquer les œuvres pour mieux les protéger est pour le moment un vœu pieu. Il est toutefois intéressant de remarquer que les sociétés d’auteurs qui aimeraient apposer une signature numérique sur chaque œuvre non seulement ne disposent pas des moyens pour le faire mais ne sont, en aucune manière, capables de les tracer et donc de les protéger. Dans ce domaine de la « surveillance » de l’utilisation des œuvres des initiatives se développent. Actuellement, la société Pixtrakk, qui vient de se lancer et observe pour des agences de contenu photographique l’ensemble de la presse papier, annonce d’ores et déjà un service identique sur le Web concernant uniquement les sites d’actualité. C’est un début mais si dans le futur quelqu’un est capable de contrôler l’ensemble des flux il y a fort à parier qu’il s’agira d’un spécialiste des réseaux, d’un acteur majeur d’Internet comme Google ou Microsof. Celui qui pourra contrôler les flux, sera seul en mesure de proposer aux artistes de « protéger » leurs œuvres. On peut imaginer alors que ces sociétés proposent aux auteurs des systèmes de gestion des droits. Exemple : « Prenez une galerie chez nous, nous marquerons vos œuvres et nous en contrôlerons les flux. Vous avez accès en temps réel à l’information : vous pouvez savoir combien de personnes sont en train de consulter votre œuvre, combien l’ont copiée sur leur ordinateur. Vous pouvez communiquer avec elles, gérer vos droits en direct, les inviter à votre prochain vernissage… » Un rêve pour les uns, des soucis pour les autres. « Le numérique n’est pas une remise en cause fondamentale de ce qui existe aujourd’hui, il ne vient pas remplacer l’existant, il vient développer de nombreuses alternatives. Le numérique, c’est la diversité. Demain il y aura encore des ventes aux enchères, mais l’artiste aura des manières extrêmement différentes de vivre sa créativité, d’avoir des relations avec les intermédiaires et avec le public », conclut Jean-Marc Wallet.
Mardi prochain : Sécurisation et protection des œuvres numériques