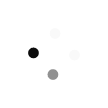« Qui est l’ennemi public ? », s’interroge la galeriste Magda Danysz. Une réflexion traduite par une exposition, dont elle partage le commissariat avec Barbara Polla (galerie Analix Forever), et par la sortie d’un livre, qui rassemble écrits et témoignages sur l’enfermement, la condition du prisonnier, sa capacité de création et l’« esthétique de l’univers carcéral ».
Au 78, rue Amelot dans le XIe arrondissement de Paris, les fenêtres ont des barreaux. Opportune parure pour la galerie Magda Danysz qui présente actuellement une exposition sur le thème de l’enfermement et nous entraîne à la poursuite de l’ennemi public. A droite de l’entrée, Mounir Fatmi présente des bouteilles d’un condiment rouge. Elles sont six à se dresser dans leur plus simple appareil et à narguer l’esprit toujours en quête de compréhension. Photographiées, elles apparaissent dans un format plus important. L’œil s’accroche alors à la panthère noire dessinée sur l’étiquette et intime l’ordre au cerveau de décoder ce qu’il pressent comme étant la clé du mystère. Une voix discrète mais néanmoins assurée explique alors sans ostentation : « Il s’agit d’un produit commercialisé aux Etats-Unis par un ancien membre des Black Panthers ». Manière détournée et pacifique de faire persister l’idée d’une certaine Amérique. La jeune femme qui vient ainsi de délivrer l’information salvatrice propose alors de poursuivre la visite. Comment « survivre »
Suivent, entre autres, l’apparition, signée Vhils, d’un visage dans le bois d’une porte, les manipulations opérées par les autorités chinoises sur plusieurs photos, mises en évidence par Zhang Dali, les dessins prélevés par Jean-Michel Pancin dans la prisondésormais désaffectée d’Avignon et la lettre adressée au président Obama par l’artiste polonaise Joanna Malinowska pour demander à ce dernier la grâce de Leonard Peltier, un indien militant de l’American Indian Movement (AIM) incarcéré depuis 1976 pour un crime qu’il n’aurait pas commis. Autant de témoignages qui tirent un fil ténu entre le milieu carcéral et la société dont il est issu. Chaque œuvre pose la question de l’homme puni par ses pairs. Pour quels motifs ? De quel droit ? Dans quel but ? Politique ou de droit commun, le prisonnier est un homme et l’enfermement le transforme. « L’une des questions que nous abordons ici est celle de savoir comment exister en prison, comment “survivre” selon la définition de Derrida. Quels liens entre l’art et la prison ? (…) Pour le savoir, nous avons interrogé les artistes, eux qui se battent constamment, non pas avec l’Ennemi public, mais avec leurs ennemis intérieurs », écrit Barbara Polla.

L’esprit passe de la compassion à l’interrogation. Nulle part, il n’est fait mention des faits reprochés à tel ou tel. Barbara Polla et Magda Danysz nous obligent à abandonner les raisons de la condamnation et nous invitent à nous concentrer sur la condition d’homme enfermé, mis à l’écart, et sur le rôle que l’art peut ou pourrait jouer dans ce contexte. L’exercice est purement théorique, pour la plupart d’entre nous, comme le souligne l’écrivain et historien Paul Ardenne, mais chacune des personnes sollicitées, pour la rédaction de l’ouvrage qui accompagne l’exposition (Editions La Muette, Bruxelles, et BDL, Bordeaux), tente d’y apporter une réponse. Au fil des pages, on croise le photographe Marc Trivier, qui préféra enseigner aux prisonniers à prendre des clichés plutôt que les réaliser lui-même, l’artiste Sarah Lucas, qui fut commissaire d’une exposition constituée de plus de 190 œuvres réalisées par des prisonniers, le peintre Gérard Kerguillec, qui mène des projets artistiques en milieu carcéral ou encore le collectionneur Didier Beaumelle. Les mots les plus saisissants reviennent sans conteste à Jhafis Quintero, devenu artiste en prison : « Faire de l’art, pour moi, consiste à organiser une pensée de manière esthétique, à transmettre des idées, à re-signifier. C’est le substitut parfait du crime, parce qu’il me permet d’esthétiser la transgression qui fait partie de ma nature même. Je puis alors donner une forme, sculpter mes idées et mes instincts, d’une manière différente. (…) J’aime l’art parce que je peux être moi-même, mais sans préjudice à autrui. » Voici de quoi méditer en attendant le prochain volet d’Ennemi public, cette fois consacré à celui de l’intérieur.