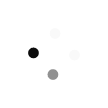C’est dans un ton proche du célèbre titre Let it be des Beatles que l’Institut des Cultures d’Islam invite à découvrir, jusqu’au 13 février 2022, l’exposition personnelle d’Hossein Valamanesh. Puisque tout passe se tient dans le cadre d’Australia Now 2021-2022, saison culturelle soutenue par le gouvernement australien pour promouvoir la diversité et la créativité de ses talents locaux. A l’instar des pop stars britanniques qui chantaient avec optimisme « qu’il en soit ainsi », le propos de Hossein Valamanesh véhicule joie et résilience. Originaire d’Iran, l’artiste plasticien installé sur l’île-continent depuis 1973 fait rayonner les différentes cultures qui constituent son identité syncrétique, ce qu’il vit comme la plus grande des richesses. Puisque tout passe présente le travail d’un esprit savant, subtil et incontestablement humaniste.
Si Hossein Valamanesh devait trouver son totem au sein du règne végétal, il appartiendrait sans doute à l’espèce des ailantes. Déraciné mais épanoui. Peut-on même dire : déraciné donc épanoui. Les ailantes, natifs des forêts de Chine et de Taïwan importés en Europe au XIXe siècle, se démarquent par leur vertu dépolluante pour les sols et leur rythme de croissance vif. A leur instar, le travail d’Hossein Valamanesh exposé à l’Institut des Cultures d’Islam, produit de ces quarante dernières années, se révèle prolifique et aussi régénérant qu’une brise printanière. Avec Puisque tout passe, on découvre un regard éclairé mais toujours en quête d’émerveillement autour de thèmes majeurs comme l’exil, la spiritualité et la nature.
Artiste plasticien, Hossein Valamanesh est un vrai touche-à-tout : photographie, sculpture sonore, collage, calligraphie, installation… Aucun médium ne l’effraie tant qu’il trouve en eux matière à exprimer sa vision personnelle et opérer la rencontre entre les différentes cultures qui l’influencent. Né en 1949 à Kash, village au nord de l’Iran, il sort diplômé à vingt ans de la Téhéran School of Art où il a développé ses techniques de peinture miniature et de calligraphie tout en se passionnant pour la peinture impressionniste. Il s’essaie ensuite au théâtre ainsi qu’à un art plus politique en réaction au pouvoir du Shah Mohammad Reza Pahlavi, puis prend le chemin de l’exil. Aspirant à une plus grande liberté et animé par l’envie de découvrir le monde, il s’installe en Australie en 1973. Arpentant ce nouveau pays, il passe plusieurs mois auprès des populations aborigènes d’Australie centrale avec lesquelles il fait l’apprentissage de nouvelles techniques. Sa terre d’accueil va fortement imprégner son travail sans qu’il ne renie ses influences et pratiques antérieures. Hossein Valamanesh est un artisan de la superposition, de la conjugaison, de la rencontre heureuse.

En Australie mais aussi en Iran, au Japon, au Bangladesh et au Royaume-Uni, les institutions accueillent son travail depuis de nombreuses années. « Au Museum of Contemporary Art de Sydney, on se presse pour découvrir son installation The Lover Circles His Own Heart », assure Bérénice Saliou, commissaire de Puisque tout passe. Admirative du travail du plasticien qu’elle décrit comme « grand sage avec l’énergie d’un enfant », elle se réjouit d’organiser sa première exposition personnelle en France. Si le travail de l’artiste a mis du temps à nous parvenir, il arrive à point. D’une résonance troublante avec les actualités sociales et politiques sur la gestion des frontières et de l’immigration, il en offre un contre-pied.
Stéphanie Chazalon, directrice de l’Institut des Cultures d’Islam, fait part de ce qui l’a interpellée dans ce travail : « Nous entretenons la liberté de ton. Le lieu expose une diversité d’artistes, qui se réclament des cultures d’Islam, qu’ils s’en inspirent ou les critiquent, et propose différentes façons d’ouvrir ces cultures à un propos universel. Pour cette raison, Hossein Valamanesh nous intéresse particulièrement. Il rend visible l’influence des cultures dans lesquelles il a baigné mais ne les restreint pas à une aire géographique. Il se les réapproprie et ne se prive pas d’en faire un usage inattendu ». Sa double identité, qu’il appréhende plutôt comme le signe d’une identité infiniment plastique, lui permet un regard singulier sur les spiritualités, traditions et coutumes qui ont marqué sa jeunesse en Iran et l’ont accompagné jusque dans son exil en Australie.
Puisque tout passe condense, en une formule poétique et équivoque, la philosophie qui a inspiré la trame de l’exposition et servi de boussole à Hossein Valamanesh dans la conduite de sa vie. Ce célèbre dicton du Golfe persique est inscrit en lettres calligraphiées de bronze dès le début de l’exposition avec l’œuvre éponyme This will also pass. Réalisée en 2012, elle témoigne d’une forte cohérence de la démarche de l’artiste. Cette lumière existentielle lui vient notamment de sa lecture du poète persan Rûmî, penseur majeur du courant soufi. Elle nous souffle une promesse de réconfort. En dépit des difficultés susceptibles de nous atteindre, « tout finira bien par passer ». En même temps, elle nous confronte au caractère irrévocable de la finitude des choses. Le mouvement est intrinsèque à notre condition : la pensée soufie est une invitation à ne pas le craindre et s’y résoudre dans la joie, voire la béatitude. Avec Puisque tout passe, nous nous immergeons au cœur de cette philosophie librement interprétée par Hossein Valamanesh. L’exposition rassemble des œuvres produites de 1980 à nos jours au sein d’un parcours thématique abordant le récit autobiographique, la nature, le surréalisme et la poésie persane.

Le mouvement initial auquel nous convie Puisque tout passe est celui de la désorientation. Une première installation nous fait déambuler entre des panneaux de gaze semi-transparents décorés du mot « amour » en farsi, inlassablement répété. De l’amour maternel à l’amour de la nature, sans oublier l’amour divin, voici la tonalité bienveillante qui nous accompagne, en route sur les chemins de l’impermanence. A cet effet, D’où tu viens ? (Where do you come from ?, 2021) propose une carte du monde fragmentée, où les pays sont superposés et mêlés les uns aux autres en reproduisant un geste artisanal de tressage à partir de bandes de papier découpées. La question sempiternelle, prononcée à chaque rencontre comme un filtre permettant de se figurer l’autre, l’inconnu, l’étranger par des repères identitaires figés dans les lieux, se trouve joyeusement déjouée. Le jeu est une dimension essentielle du prisme par lequel Hossein observe et décrypte le monde qui l’entoure. Si tout est voué à disparaître, quoi de plus sérieux que le jeu ? A la violence sous-jacente contenue dans la question « D’où viens-tu ? », menaçant à chaque instant de nous capturer dans une identité non taillée à notre mesure, l’artiste oppose l’humour. « Je viens du coin de la rue » est sa réponse la plus courante. L’idée d’appartenance à un territoire est, pour lui, chose entièrement artificielle.
Disposé dans une étagère de l’Institut des Cultures d’Islam, on découvre un portrait sous forme de rébus. Avec lui, Hossein Valamanesh affirme un rapport renouvelé à la notion d’identité, symbolique et inventif. Un simple chapeau noir posé là, à l’image de celui qu’il ne quitte jamais, suffit pour suggérer sa personne. Le motif du portrait revient à plusieurs reprises. Toujours dans une esthétique très surréaliste, il encadre deux amandes ornées de faux cils et voilà que surgit l’image de son épouse Angela Valamanesh par un subtil jeu d’associations. Les « yeux en amandes » sont, dans la culture persane, synonyme de beauté. Plus singulièrement ici, ils contiennent une autre référence cachée et plus intime, Angela Valamanesh ayant grandi dans une plantation d’amandes qui appartenait à ses parents.
Plus loin, au détour d’un couloir, Hossein Valamanesh se dévoile un peu plus en exposant un autoportrait de lui bébé. Une représentation typique de l’Iran des années 1950, quand les familles avaient l’habitude de faire photographier les jeunes garçons et de les glorifier. Ceci en dit autant sur une tradition vernaculaire que sur lui-même, un autre détail tenant à la tendresse qui affleure de cette photographie où l’on discerne les mains caressantes de sa mère. Le récit biographique se poursuit dans la salle suivante par de curieuses installations faisant éprouver un sentiment d’inquiétante étrangeté. Trois éléments associés ensemble dans l’œuvre Daily Bread (1995) – un tchador, une silhouette et un pain sangak – convoquent un souvenir plaisant. Hossein Valamanesh raconte qu’enfant il percevait le tchador de sa grand-mère comme une tente merveilleuse sous laquelle il aimait se lover. Certains éléments, comme le tas de cailloux au pied de la silhouette féminine, pourraient aussi prêter à une lecture plus sombre et politique. Pour Bérénice Saliou, toutes les interprétations sont valides : « Une multitude de choses converge dans le travail d’Hossein Valamanesh. Et il en joue ! Il est très curieux de découvrir le sens que l’on tire de ses œuvres ».

Pour approfondir le trait introspectif, une partie de l’exposition est consacrée à l’entre-deux identitaire et son expérience de l’exil. Avec Sifting Through, Gold Was Found Here, il donne consistance à une silhouette décharnée au moyen de différentes terres glanées dans les montagnes de Flinders, en Australie Méridionale, soulignant le lien organique qui l’unit à sa terre d’adoption. On retrouve dans la même salle la photographie Longing Belonging (Se languir d’appartenir, 2021) représentant un tapis traditionnel Qashqā’i (peuple nomade installé en Iran depuis le 12e siècle) enflammé au milieu d’un paysage aride du bush australien. Une image de celles que l’on garde pour longtemps en mémoire, à la forte puissance d’évocation. Hossein Valamanesh a choisi de la réaliser quand il s’est rendu compte qu’il avait désormais vécu plus longtemps en Australie que dans son pays natal. Il a souhaité marquer le coup en brûlant ce tapis qu’il l’a accompagné à travers les différentes étapes de sa vie dans un feu qui est tant feu de sacrifice que de célébration, de nostalgie que d’exaltation.
Quelques indices nous amènent à penser qu’Hossein Valamanesh tire un certain plaisir à se perdre, à naviguer dans la zone floue de l’indétermination. L’expérience de l’identité multiple lui a ouvert de nouveaux horizons. Sa pratique de l’autoportrait mêle souvent des bribes de récits réels et fictifs, ainsi que des éléments des paysages incorporés. Loin de subir sa double identité comme une coupure qui l’arracherait à toute attache, Hossein Valamanesh travaille dans un désir de faire découvrir ses différentes cultures et de leur rendre hommage. Avec l’installation vidéo immersive Char Soo, qui signifie « quatre directions », l’artiste nous plonge dans l’ambiance locale du grand bazar de la ville d’Arak en Iran de l’aube au crépuscule. Non loin, la sculpture Lotus Vault2, produite par découpage et collage de fragiles feuilles de lotus, réactive les formes géométriques typiques de l’architecture de la mosquée d’Ispahan tout en rappelant des dessins de l’art aborigène dans un joyeux mélange des genres. Le dépaysement opéré est moins celui d’un exotisme que d’une attention portée aux micro-récits du quotidien qui animent les différents espaces.
A ce stade, le parcours est dense et on est pourtant loin d’avoir épuisé toutes les facettes du travail du plasticien. Arrivé à l’ancien hammam, il est cette fois temps de plonger au cœur de la mystique soufi. Hossein Valamanesh s’est épris de celle-ci, y voyant une saisie du sens de la vie moins réductrice et manichéenne que celle proposée par les principaux courants religieux. Elle consiste en une pensée humble qui pourrait se résumer ainsi : accepter de ne pas tout pouvoir comprendre. La célèbre installation The Lover Circles His Own Heart, exposée Museum of Contemporary Art de Sydney, a été reproduite sur place. On voit prendre forme la fascinante « danse sans danseur », comme le décrit Hossein Valamanesh, engendrée par le flottement circulaire d’un linge blanc suspendu par le haut. Cette figure spectrale se livre comme une initiation à la méditation contemplative. Rappelant les mouvements des derviches tourneurs, Hossein Valamanesh précise que « c’est une danse qui embrasse la totalité sans évoquer une personne en particulier ».

La mystique évoquée par l’artiste, nourrie de citations textuelles empruntées à Rûmî, se prolonge d’une cosmologie où la nature occupe une place centrale, en étroite connexion avec tout l’univers. Les sculptures prennent des atours organiques, associant branchages et réseaux sanguins (Fallen Branch, 2005). Une mathématique universelle se dégage à partir des similitudes formelles entre l’infiniment grand et le microscopique. Planètes ou bactéries, les choses ont aussi en commun d’être périssables. La nature constitue une source d’inspiration et de matériaux inépuisable pour l’artiste. Elle lui permet de surmonter la perte de repères identitaires induite par le relativisme culturel dont il fait part. Hossein Valamanesh entretient le sentiment d’une totalité plus vaste, d’un grand Tout qui rassemble chacun des êtres et éléments qui composent le monde. Cette magie de l’immanence trouve sa traduction sonore avec l’installation Birch Song, symphonie composée à partir des irrégularités d’un morceau d’écorce de boulots converties en notes de musique. Selon l’artiste, créer tient avant tout en une capacité d’attention et d’empathie.
L’exposition s’achève avec une énigme, un jeu conçu par l’artiste pour poursuivre le cheminement spirituel par un geste concret. Un indice : il vous faudra, comme lui, apprendre à aller au-devant des choses et accueillir l’inconnu comme une ressource.
Contact> Hossein Valamanesh – Puisque tout passe, jusqu’au 13 février 2022, à l’Institut des Cultures d’Islam, Paris. www.institut-culture-islam.org
Image d’ouverture> Sifting Through, Gold Was Found Here, Hossein Valamanesh, 1985. ©Hossein Valamanesh, photo Manon Schaefle